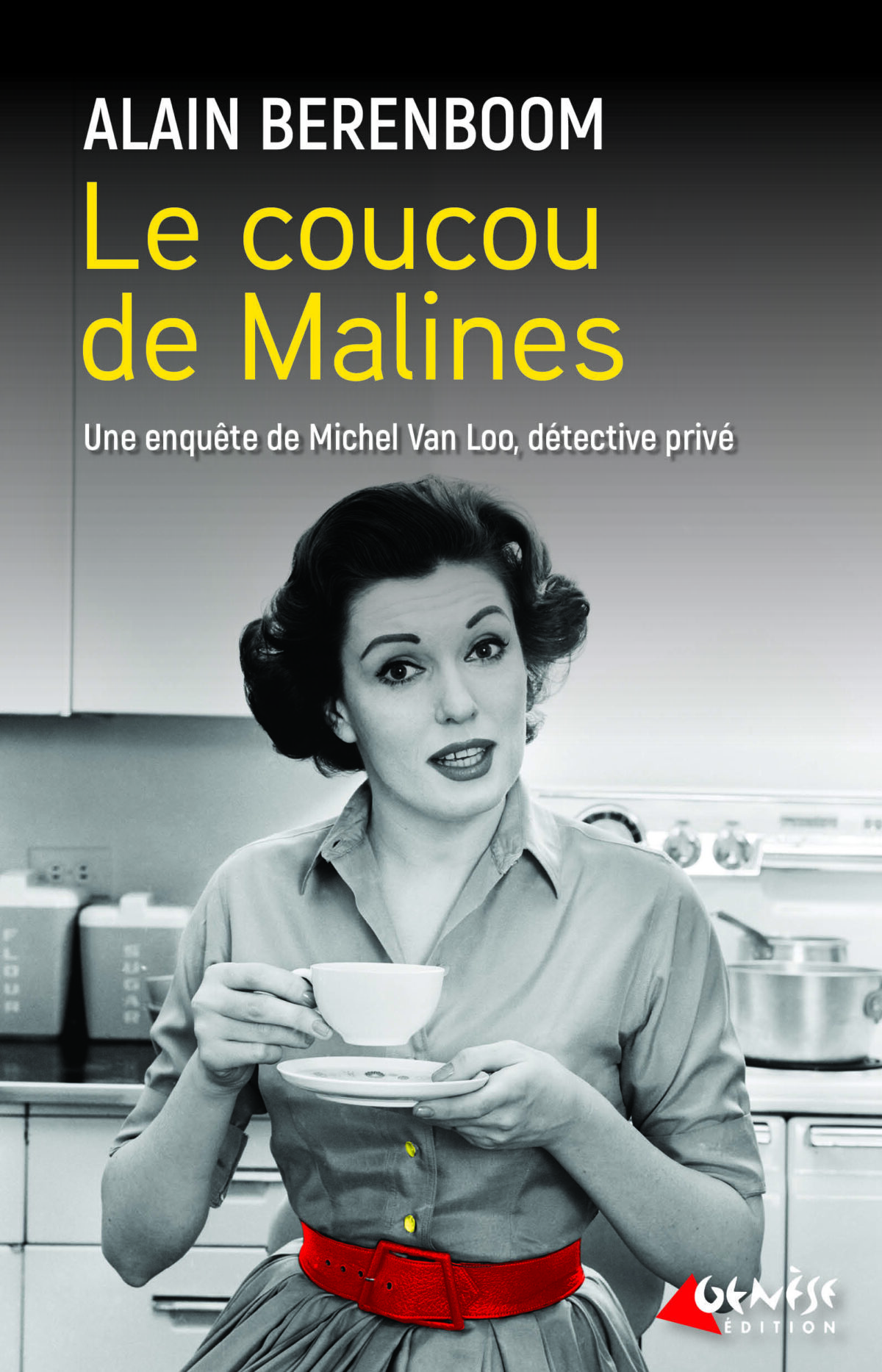« Enquêter à Malines ? Moi ? C’est une très mauvaise idée. Je n’ai jamais mis les pieds dans cette ville, je ne la connais pas, je n’y connais personne. (Je me sentis rougir mais je tenais à être honnête même si j’ai désespérément besoin de boulot). Et surtout, je ne parle pas un mot de flamand !
– Je ne vous paye pas pour causer, Monsieur Van Loo. Au contraire. Je voudrais que vous filiez le plus discrètement possible cette dame. Si j’engageais un détective local, elle risque de le reconnaître. Malines est une petite ville, vous savez. Personne ne se méfiera de vous. Vous aurez l’air d’un touriste un peu égaré.
Mon client s’appelait Diego Bloemkool. Du moins, c’était le nom imprimé (en relief s.v.p.) sur la carte de visite qu’il me remit avant même de s’asseoir. En dessous de son nom, export-import en petits caractères. Suivi d’une adresse à Malines, 45 Bruul. Je hochai la tête. Même moi qui n’ai visité qu’une fois l’ancienne capitale des Pays-Bas (lors d’un voyage scolaire), je savais que Bruul était l’artère la plus prestigieuse de la ville. Ce qui m’incita à accueillir M. Bloemkool les yeux fermés ou à peu près et à arrondir le montant de mes honoraires vers le haut. Une double erreur.
L’homme était une espèce de colosse. Une carrure impressionnante, au moins 1,95 mètres à vue de nez. Sans autre signe particulier. Réservé, sérieux, la voix grave. Ses lèvres très minces semblaient ne pas bouger quand il s’exprimait. Un ancien ventriloque ?
J’aurais dû refuser cette enquête mais le type m’impressionnait. Si je disais non, je savais qu’il n’allait pas me frapper. Mais une inquiétude absurde me collait à ma chaise et m’obligeait à clouer le bec. Ajoutez-y l’appât du gain. Mon bureau battait de l’aile et je ne pouvais me payer le luxe, malgré ma répugnance, de refuser même une filature. Le genre d’affaires que je n’aime pas en temps normal. Ce terme élégant décrit la mission pas très glorieuse d’apporter à un époux, une épouse ou un fiancé la preuve de la trahison de son partenaire. Avec photos ou lettres en guise de cerise sur le gâteau.
Bloemkool, donc. Si je n’avais pas négligé mes cours de néerlandais à l’école, ce nom aurait dû me faire tiquer. Qui peut réellement s’appeler Chou-Fleur ?
De peur qu’il consulte un de mes collègues, je repoussai mes réticences et je me contentai d’une maigre provision, de quoi couvrir mes premiers frais. Le train, les bières, nécessaire pour m’aider à patienter. Il me glissa quelques billets sans demander de reçu. Cela aussi aurait dû me mettre la puce à l’oreille.
A la sortie de la gare (Station Mechelen), un bâtiment tarabiscoté de fer et de verre mais mal entretenu, qui a dû être impressionnant au siècle dernier, je m’arrêtai devant le mijlpaal, une colonne de pierre gravée, qui ressemblait à une sorte de borne romaine ou à la colonne restante d’un temple disparu. A l’image que la ville voulait se donner, la dernière trace d’un empire qui a sombré depuis longtemps. Sur la place, face à la gare, de petites maisons provinciales sans âme et plusieurs bistrots. Je poussai un soupir de soulagement. Ah ! Un décor familier. Dans le café, à l’enseigne de Lamot, la bière locale, régnait une atmosphère joviale. Quelques jeunes jouaient au billard dans un coin, d’autres au kicker. Un juke-box diffusait de la musique country, du rock et des chansons flamandes. Après avoir vidé une gueuze grenadine, alors que j’allais sortir du café, un peu trop enfumé à mon goût, j’aperçus par la vitre une grande agitation dehors. Un pompier poussa la porte et lança quelques phrases auxquelles je ne compris rien. Mon voisin, un représentant de commerce, venu par le même train que moi, me traduisit.
« On nous demande de ne pas bouger. Remarquez, on pourrait être plus mal. Il y a un incendie. Une maison voisine en feu. »
On entendait des sirènes. Des ambulances défilaient, des voitures de pompiers, des policiers, des gens couraient l’air grave, une foule de curieux.
C’est quoi cette ville ? A peine débarqué, j’étais obligé de rester confiné avec le bruit d’une catastrophe dans les oreilles. J’aurais mieux fait de retraverser la place et de repartir immédiatement à Bruxelles en abandonnant cette enquête devant laquelle je renâclais depuis le début. Mais je balayai ces réticences, fit taire la petite voix qui me soufflait de fuir Malines et je ne pensai plus qu’au montant des honoraires qui m’attendaient. Quelle erreur !
Une heure (et trois gueuzes) plus tard, quand on fut autorisé à sortir, l’odeur de fumée prenait à la gorge. Plus encore que dans le bistrot. Non loin de là, un bâtiment achevait de se calciner. La façade défoncée, noirâtre. Je ne m’attardai pas. J’avais repéré sur un plan de la ville le quartier dans lequel vivait la dame que Bloemkool m’a demandé d’observer et l’adresse du magasin dans lequel elle travaillait.
La dame s’appelait Gertrude De Vijver. Sa future épouse à l’en croire. Une trentaine d’années. Vivant seule à Malines. Il voulait s’assurer qu’elle menait « une vie irréprochable » selon ses termes. C’est ce qu’il prétendait.
Où l’a-t-il rencontrée ? Chez des amis deux mois auparavant (j’avais omis de demander leur identité). Elle l’a immédiatement charmé (« hypnotisé » insista-t-il les yeux brillants). D’après lui, elle n’était pas restée insensible à ses invitations. Restaurant, dancing, cinéma. Au fil de leurs rencontres, elle a laissé entendre qu’il lui plaisait. Et lui qu’il était prêt à s’engager. Mais, avant de se déclarer, il tenait à s’assurer de sa « moralité » (je le cite).
Quel homme sympathique ! Qui contrôlait les qualités de la femme de sa vie comme un fermier examine les dents du cheval qu’il se propose d’acheter. Si mon compte en banque n’avoisinait pas le zéro, j’aurais mis en garde cette pauvre Gertrude. Mais je n’en avais hélas pas les moyens.
Sentant ma réticence, mon client précisa qu’il opérait ainsi avec tous ses collaborateurs. Un nouveau fournisseur, un nouveau client, un commanditaire, il vérifiait toujours leur fiabilité avant de faire affaire avec eux. A plus forte raison vis-à-vis d’une future compagne avec laquelle il espérait se lier pour la vie.
J’avais tellement besoin d’argent que je fis taire mes scrupules surtout quand il ajouta que, si mes services lui donnaient satisfaction, il me confierait désormais le soin de tester tous ses futurs partenaires commerciaux.
Gertrude De Vijver vivait dans un quartier tranquille, boisé, du côté du Mechels Broek, un espace naturel non loin des méandres de la Dyle qui semblait s’être détachée de la ville pour s’égarer au milieu des bois, avec ses maisons basses envahies par la verdure et ses petits commerces d’autrefois. Images d’une vie arrêtée dans le temps. Le facteur, la concierge d’une des villas voisines, le cafetier au bout de la rue, tout le monde était disposé à lâcher quelques mots à propos de Gertrude. Il est toujours facile d’enquêter dans une petite ville. Les gens adorent papoter. Ils connaissent tout de leurs voisins. Et, à Malines, à mon grand soulagement, ils étaient fiers d’étaler leur maîtrise du français à un type venu de la capitale qui ne possédait que des notions très approximatives du néerlandais.
Tous ces bavardages me permirent d’apprendre que Madame De Vijver s’était mariée très jeune à la fin de la guerre avec un certain Théo, mort quelques semaines plus tard. Membre de la résistance, il avait été arrêté par les Allemands, enfermé à la caserne Dossin, puis envoyé vers les camps nazis dont il n’était pas revenu.
Depuis, Gertrude vivait seule. La première fois que je l’aperçus, elle attendait l’autobus. Petite, gracieuse, élégante. Avec un petit chapeau accroché sur le coin de la tête. Elle semblait discrète jusqu’à ce qu’on remarque ses grands yeux bleus glacier et ses lèvres sensuelles. Lorsque je m’approchai d’elle, elle se raidit alors que je feignais d’attendre le bus comme elle en compagnie de cinq ou six autres personnes. Le regard qu’elle me lança me donnait l’impression d’être radiographié. Je tournai la tête avant de plonger dans mon journal. Vivait-elle sur ses gardes ? Se sentait-elle menacée ? Ou était-elle simplement nerveuse ? Quand on file quelqu’un, on a tendance à se faire des idées.
Tous les matins, elle se rendait dans un magasin de peinture non loin du centre-ville, Het Atelier, où elle travaillait toute la journée, enveloppée dans un cache-poussières blanc étincelant. Sa famille ? Personne n’en a entendu parler. Père, mère, frère ou sœur ? Peut-être vivaient-ils dans une autre ville ? Pendant les deux semaines de mon enquête, elle rencontra quelques messieurs (trois), chez elle, l’un à deux reprises. Ils ne s’attardaient pas, une heure tout au plus. Aussitôt immortalisés avec mon Kodak Brownie. Clic, clac ! Un soir, elle rejoignit deux hommes et une femme dans un restaurant, que je n’osai pas photographier. De crainte de me faire repérer à cause du flash.
Des amis, des membres de sa famille ? Des amants de passage ? Amours tarifés. Non, non. Je ne pouvais le croire. Sa personnalité, son regard le démentait. On sentait une femme droite, ferme. Mais je ne savais encore rien de Gertrude. Je l’aurais découvert si j’avais bénéficié d’un peu plus de temps. Mais Bloemkool était pressé. Il m’appela au bout de dix jours pour me demander un premier compte-rendu. Demain dix heures à votre bureau ?
Lorsque je lui remis mon bref rapport, accompagné des clichés, il parcourut le texte et contempla les photos sans poser de question puis rangea le tout dans sa serviette en me remerciant pour mon travail qui « répondait à ses attentes ». Je souris. Le taximètre était lancé pour une longue course. Or, au lieu de me faire poursuivre mon enquête, identifier les hommes que j’ai repérés en compagnie de Gertrude, approfondir ses relations avec eux, il m’assura qu’il était « complètement satisfait » et il partit, emportant ma facture. Merci. Au revoir. Fin de la séquence ?
Quand je me demandai enfin s’il m’a dit la vérité, à quoi rimait cette enquête-expresse et qui était vraiment Diego Bloemkool, il était trop tard. Mon enquête terminée (à la satisfaction de mon client), ma facture restait désespérément impayée malgré de nombreux rappels. Ma dernière lettre, envoyée par pli recommandé, m’était revenue « non retirée ». Puis les précédentes avec la mention « inconnu à cette adresse ». Sur la carte de visite que le client m’avait fièrement glissée, ne figurait aucun numéro de téléphone. Quelle négligence stupide de ne pas avoir remarqué ce détail ! Pour encaisser mon dû, il me restait à me rendre en personne au Bruul et à lui tirer les oreilles. Des oreilles en forme de chou-fleur, comme me le révéla Anne, ma fiancée, qui connaissait le néerlandais L’affaire sentait mauvais…
Le rez-de-chaussée du numéro 45 sur le Bruul était entièrement occupé par les deux élégantes vitrines d’un fourreur. Son nom discrètement tracé en lettres d’or, Rosenkohl. Où se trouvaient les bureaux de Bloemkool ? Dans les deux étages au-dessus du magasin ? Ils semblaient inhabités. Comment s’en assurer alors qu’il n’y a ni porte de rue ni sonnettes ?
Mr Rosenkohl, petit, maigre et sec, semblait prématurément vieilli. A voir les traits de son visage, il ne devait pas avoir plus de quarante ans, ce que démentait son ton blafard et ses rares cheveux de la blancheur du lys. Il s’avança vers moi d’un pas lent. D’un simple coup d’œil, il comprit que je ne venais pas acheter un manteau d’astrakhan. Mais il eut la délicatesse de ne pas me mettre immédiatement à la porte. Lorsque je lui demandai s’il connaissait un certain Diego Bloemkool et si ses bureaux occupaient un des locaux au-dessus de son magasin, il éclata de rire.
« Vous êtes huissier, je parie ?
– Détective privé. Michel Van Loo.
J’étais le cinquième créancier à me manifester depuis le début du mois. Trois huissiers. Et un vendeur de voiture qui a laissé un véhicule (de luxe) à mon client en échange d’un important acompte, payé avec un chèque en bois.
Je n’étais pas de taille à rançonner ce genre d’individu. Il jouait dans une autre catégorie. Il ne me restait qu’à classer le dossier par pertes et profits. Et bye bye. Je saluai le fourreur et tournai les talons. Il m’arrêta sur le seuil.
– Quel est le montant de vos honoraires, monsieur Van Loo ?
Une question que Bloemkool ne m’a pas posée. Quand je lui indiquai mon prix forfaitaire par jour, il me proposa une mission d’une semaine.
« Vous comprenez, Van Loo, j’en ai assez de voir débarquer dans mon magasin une à une toutes les victimes de ce bonhomme. L’arrivée des huissiers met mon personnel mal à l’aise. Et leur présence est gênante pour la clientèle. De plus, un avocat un peu ficelle risque de m’accuser de porter un nom qui n’est qu’une déclinaison du sien. De là, à prétendre que lui c’est moi… »
Je ne l’avais pas remarqué jusqu’à ce qu’il me précise que Rosenkohl signifie chou rouge en allemand.
« Cet individu n’a pas adopté son identité par hasard, croyez-moi. Il a pris un malin plaisir à repérer mon adresse et imprimer des cartes de visite en imitant mon nom. J’ai l’impression que ce type me cherche des poux, je ne sais pourquoi. Et ça m’agace. Eh bien, je veux qu’on l’appréhende. Il mérite de passer en correctionnelle, vous ne trouvez pas ? »
Je lui serrai la main. Ce genre d’enquête entrait parfaitement dans mes cordes, l’assurai-je. Tout en me réjouissant de la chance d’être payé pour mettre la main sur un gaillard que je voulais de toute façon épingler. Ah ça, on ne se moquait pas impunément de moi !
Avant de quitter Malines, je fis un tour de la ville pour m’imprégner de son décor et de son atmosphère. Ce que j’aurais dû faire quand je procédais à la filature. D’habitude, je me familiarise avec les lieux où se déplace la personne que je suis chargé d’observer, je hume l’atmosphère locale. Cette fois, j’avais bâclé le boulot, désarçonné par mon arrivée au milieu des fumées d’incendie. Et interrompu, il est vrai, beaucoup plus tôt que je ne le pensais. Pourtant, Bloemkool n’a certainement pas choisi au hasard le lieu de ses méfaits et l’adresse de son faux quartier-général.
Quelques verres de « Mechelchsen bruynen » me permirent rapidement de me plonger dans l’esprit de la vieille ville. Une bière brassée depuis le quatorzième siècle me précisa le tavernier qui portait une si épaisse moustache qu’on ne pouvait deviner si elle dissimulait un bec-de-lièvre ou un sourire ironique lorsqu’il ajouta que Marguerite d’Autriche, gouverneure des Pays-Bas, avait établi sa capitale à Malines sur les conseils de son médecin qui lui a susurré que ce nectar donnait à certaines femmes d’exception un orgasme dans les deux heures.
« Et les hommes ?
– N’hésitez pas à revenir me faire part de votre expérience.
De retour à Bruxelles, je feuilletai le dossier Bloemkool. Quelques feuilles à peine. Le fil qui menait à mon escroc de client devait se trouver quelque part dans les informations qu’il m’a données ou dans celles que j’ai recueillies. En relisant mes notes, j’entendis sa voix. Un peu pincée avec une pointe de sarcasme. Un français parfait, châtié, encombré d’expressions démodées. Comme beaucoup de Flamands lettrés qui connaissent parfaitement notre langue et se flattent de la parler aussi bien sinon mieux que leurs interlocuteurs francophones. Alors que les bourgeois de Bruxelles ou de Liège sont fiers de ne pas connaître un mot de néerlandais.
Ma facture, le salaud ! Je voulais la lui remettre en mains propres, cette facture qui m’est revenue « inconnu à cette adresse ». La lui coller sur la figure. Mais je sentais bien que je n’étais pas au bout de mes peines.
Anne entra dans mon bureau pendant que je feuilletais la fin de mon rapport d’un air dégoûté. Je levai les yeux. Elle portait les cheveux plus courts qu’un garçonnet.
– Retiens tes yeux, Michel, sinon ils vont tomber par terre. Tu as croisé un extra-terrestre ? (Elle secoua la tête, ce qui ne fit pas bouger un seul de ses minuscules cheveux). Dis-moi si je me trompe, mon chou. J’ai l’impression que tu n’aimes pas ma coupe ?
– Je te prie de retirer le mot chou de ton vocabulaire. Quelqu’un s’est attaqué à ta coiffure avec rage ou a-t-elle été carbonisée sous le casque de ton patron ?
Anne, ma belle fiancée (quand elle portait les cheveux longs) travaillait dans le salon de coiffure situé en-dessous de mon bureau dont le patron, Federico, était aussi mon propriétaire.
– A propos de Federico, peux-tu le prévenir, avec ta diplomatie habituelle, que mes fins de mois risquent d’être provisoirement difficiles ?
Anne me tendit la photo de Jean Seberg qui venait de triompher dans le rôle de Jeanne d’Arc. Nous avions vu le film d’Otto Preminger la semaine précédente au cinéma Marivaux. On ne pouvait contester un air de ressemblance entre Anne et Jeanne.
– A l’époque, on appelait cette coupe une chevelure en sébile.
Elle passa son index au-dessus de son cou pour souligner sa coupe en rond au-dessus des oreilles, sa nuque et ses tempes rasées. Je levai les mains, vaincu par les assauts de la Pucelle.
– Terriblement sexy, c’est vrai. Je comprends que les ennemis de Jeanne se soient enfuis en la voyant s’avancer vers eux.
– Sauf l’évêque Cauchon, qui portait sans doute bien son nom.
– Ta réincarnation de la Pucelle d’Orléans tombe à pic, Anne. J’ai sacrément besoin de ton épée et de ton destrier.
J’agitai en l’air la copie de mon rapport pour le Chou-Fleur. Anne le parcourut, assise sur un des accoudoirs du fauteuil.
Après l’avoir refermé elle le jeta sur ma table.
– Vide, creux… Il n’y a rien à en tirer, mon pauvre Michel. Tu as rarement été aussi mauvais !
Je hochai la tête. D’accord avec elle. Je m’étais réservé pour la suite de la mission. Imagine ma tête quand il y a mis fin alors que je n’avais grapillé que des miettes. Je me retrouvais le bec dans l’eau. A part le nom de sa soi-disant future épouse, Gertrude De Vijver, pas le moindre indice ne permet de remonter jusqu’à mon sacré client. Sinon les ombres qu’elle a croisées au fil de ses rencontres.
« Tu ne précises pas la nature de leurs relations. Seulement amis ? L’un d’eux, son amant ? Tous peut-être ? lança-t-elle avec un air coquin.
Je levai les bras au ciel.
– C’est la question que Bloemkool aurait dû poser s’il cherchait vraiment à s’assurer de la moralité de sa future promise. J’ai été tout à fait surpris qu’il ne me charge pas de poursuivre mes investigations, d’identifier les hommes qu’elle rencontrait. S’il voulait vraiment s’assurer de sa soi-disant moralité. La lecture de mon rapport achevée, il est parti, aussi joyeux que si je lui avais offert une glace à la chantilly. Fin de ma mission.
– Avant même de l’avoir vraiment commencée… A ton état d’énervement, je devine que tu ne vas pas en rester là…
– D’abord, vérifier dans les registres de l’état-civil de Malines si un mariage a été célébré entre Diego Bloemkool et Gertrude… Zut, je ne connais même pas son nom de jeune fille !
– Inutile de perdre ton temps. Tu feras chou blanc…
– De la maison communale, je me rendrai alors chez Madame De Vijver…
– Bonjour, je vous ai suivie sournoisement pendant quinze jours sur la demande d’un certain Chou-Fleur, je possède une collection de photos de tous les hommes que vous fréquentez… Tu seras bien reçu, mon pauvre Michel ! Mets-toi à sa place !
Je laissai tomber les bras. Anne a raison. Comment l’approcher sans l’effaroucher ? Mentir une fois encore ? Renoncer ? Mais, sans son aide, comment remonter jusqu’à mon mystérieux client, le parasite qui s’est emparé de l’adresse du fourreur Rosenkohl ? Je jetai le rapport à la poubelle. A quoi bon m’obstiner ? Tant pis pour ma facture ! Federico acceptera certainement de me faire à nouveau crédit pour le loyer de mon misérable cagibi avec un petit coup de pouce d’Anne …
– Surtout s’il veut se faire pardonner ce massacre, ajoutai-je en fixant la tête rasée de ma chère Anne.
– On verra cette nuit si ma coupe ne te plaît pas, dit-elle l’air boudeur.
Elle se pencha vers la poubelle et récupéra les papelards que je venais de jeter. En me faisant remarquer que les clichés pouvaient encore servir.
– Malines est une petite ville. En interrogeant les passants dans les rues ou les endroits où tu as immortalisé ces rencontres, quelqu’un reconnaîtra peut-être sur les clichés l’un des amis de Gertrude…
Pendant qu’elle me parlait, une idée me traversa l’esprit qui aurait dû me frapper bien plus tôt. Comme d’habitude, j’étais lent à la détente.
– On annonce le retour du soleil dimanche. Que dirais-tu d’une promenade bras dessous bras dessus à travers le Mechels Broek ? Puis, après un déjeuner au bord de l’eau, une balade en canot.
Anne éclata de rire.
– Je me demandais quand tu allais me supplier d’interroger les promeneurs du quartier. Pendant ta première vadrouille du côté de chez Gertrude, tu as eu de la chance de tomber sur un facteur et une voisine aimable qui bredouillaient quelques mots de français. Mais pour une enquête plus poussée au fond de la province d’Anvers, rien ne vaut l’assistance d’une vraie néerlandophone…
Elle me déposa un bref baiser sur les lèvres mais s’échappa quand je tentai de la prendre dans mes bras.
Anne Van Soest était née dans une famille flamande du nord de Bruxelles. Elle me promit de cacher son accent bruxellois et d’adopter celui des environs de Malines – qu’elle connaissait grâce à une tante à Lierre qui l’accueillait souvent pendant son enfance. En province, on n’aime pas les gens de la capitale. Et on s’en méfie. Pour un Anversois, un Flamand de Bruxelles est aussi étranger qu’un Wallon ou un Italien.
Je savais que ce n’était pas seulement pour me servir de traductrice qu’elle était prête à m’accompagner à Malines. Elle s’est souvent moquée de moi quand je parlais de « prospecter la clientèle flamande » – généralement après deux ou trois gueuzes grenadine. « On dit qu’il y a de plus en plus d’argent dans le nord du pays et pas encore beaucoup d’enquêteurs privés. »
« Tu vois la Flandre comme une espèce de Far West au temps de la ruée vers l’or ? Et les Flamands, tu les ranges parmi les Indiens ou les cow-boys ? »
Avant d’ajouter qu’on n’est pas capable de fouiller les coins sombres, d’arracher le moindre secret, bref de mener convenablement une enquête si on ne sait rien du pays et de ses habitants et qu’on ne parle pas la langue. Elle m’avait même proposé à plusieurs reprises de me donner des leçons pour rattraper celles que j’ai négligées de suivre au lycée. Mais ces cours se terminaient généralement sous la couette avant même d’avoir commencé. Cette fois, elle tenait une bonne raison de me faire plonger dans la culture flamande et ne voulait pas louper l’occasion. Ce qui me faisait prendre conscience de l’importance que représentait pour elle la langue de son enfance. Je ne m’en étais pas rendu compte parce qu’à Bruxelles, elle ne s’exprimait qu’en français, avec les clientes du salon, avec moi et nos amis. De temps en temps en bruxellois, un patois mélangeant français et flamand. Mais très rarement en néerlandais. Je comprenais mieux pourquoi sa bibliothèque était pleine d’auteurs flamands. Ma façon de résister à nos colonisateurs ! m’a-t-elle confié un jour.
On se retrouva seuls dans le compartiment du train qui menait à Malines. Pendant la semaine, le train était bondé mais peu de Bruxellois passaient le week-end dans l’ancienne capitale de Marguerite d’Autriche. En cette fin d’automne, légèrement frisquet malgré un beau soleil imprévu, les touristes ne se pressaient pas.
Je fis une croix sur la maison communale – fermée, on était dimanche. De toute façon, ce soi-disant mariage était une fiction. Autant aborder immédiatement Madame De Vijver. Si c’était son nouveau mari qui ouvrait la porte, bingo ! Sinon, il ne restait plus qu’à m’expliquer avec elle, aidé par Anne.
J’eus des scrupules à sonner à sa porte sans m’être annoncé. Elle risquait de me repousser comme un vulgaire colporteur. Pourtant, si je l’avais fait, la suite des événements n’aurait pas tourné à la tragédie. Dans une cabine, en face de la gare, pendait un annuaire de téléphone intact (braves gens de Malines, si respectueux des biens publics). Son nom figurait sagement dans la colonne de droite. Elle décrocha dès la seconde sonnerie. Anne était à mes côtés. Si Gertrude De Vijver ne parlait pas français, je lui passerais le combiné. Ce fut inutile. Elle s’exprimait parfaitement avec un délicieux accent chantant qui lui donnait l’air espiègle. Et une voix douce, chaude, profonde à laquelle on n’a pas envie de débiter des mensonges. Après m’être présenté sans faux-fuyant (Michel Van Loo, détective privé à Bruxelles), je lui expliquai que j’étais venu à Malines pour la rencontrer. On m’a confié une mission qui me gênait et qui la concernait directement. Acceptait-elle de me recevoir ? Il y eut un si long silence que je crus qu’elle a raccroché. (Je ne lui en aurais pas fait le reproche). Je me préparais à combler le vide en lâchant le nom de Bloemkool mais Anne, qui me devinait, me serra le bras.
« Contiens ton impatience » chuchota-t-elle.
« Je ne comprends pas, reprit Gertrude. Vous êtes détective privé ? Pourquoi vous intéresser à moi ? »
Je lui répétai que je voulais lui expliquer de vive voix comment elle s’était trouvée au centre d’une de mes enquêtes. Un long silence à nouveau suivi de cette question inattendue : « A propos de mon mari ? »
Parlait-elle de mon client ? Auquel cas j’avais tout faux. Non, de Théo, son mari disparu dans les camps, certainement.
Je ne voulais pas mentir mais j’étais tenté de m’accrocher à la perche qu’elle me tendait pour l’approcher. Anne s’empara du téléphone et poursuivit la conversation en flamand.
Elle me traduisit leur échange après avoir raccroché. Dès qu’elle expliqua à Gertrude que je m’interrogeais sur le rôle de Théo dans la mission qu’on m’a confiée, elle nous fixa rendez-vous. Deux heures plus tard. Le temps de terminer un travail. Voilà qu’elle s’excusait presque alors que c’est moi qui imposais notre présence. Un peu surprise, peut-être contrariée ou inquiète mais d’une voix toujours aussi douce et piquante, elle me donna son adresse (que je connaissais déjà). Au moment de quitter la cabine, j’ignorais que c’était la dernière fois que j’entendais résonner sa belle voix.
Sa coquette petite maison à un étage, entourée d’un petit jardin m’était bien connue. Je l’avais observée plusieurs fois depuis que je m’étais lancé dans cette incompréhensible filature pour le compte de Bloemkool. Un lierre grimpait sur la façade jusqu’au balcon du premier étage. A l’arrière, une haie bien taillée la séparait des voisins. Je montrai à Anne le recoin de la maison d’en face – vide et à louer – où je m’étais dissimulé pour observer les aller-et-venue de ses amis. Elle hocha la tête avec un sourire navré.
« On y va ? »
Anne faisait bien de me secouer. Je ne savais pourquoi je restais figé, soudain hésitant à l’idée d’affronter Gertrude.
« Un moment de honte est vite passé », murmura Anne.
Certes mais ne devrais-je pas laisser tomber, me trouver de nouveaux clients plus sérieux plutôt que m’entêter à vouloir récupérer les quelques billets que me devait un escroc de bien plus haut vol que moi ? C’est Anne encore qui dut me rappeler que je travaillais pour un nouveau client, beaucoup plus sérieux, le fourreur du Bruul, qui attendait mon rapport pour la fin de la semaine.
Sur la boîte aux lettres, figurait son nom, G. De Vijver. Et celui de son mari, Théo – et non Diego. Je cherchai en vain la sonnette. J’allais frapper à la porte quand je m’aperçus qu’elle était ouverte, plus exactement entrebâillée. Anne la poussa légèrement et appela « Mevrouw De Vijver ? » Puis, d’une voix plus forte. « Kunnen we iets zeggen ? » (Pouvons-nous vous dire un mot ?)
Elle se tourna vers moi, un peu désemparée.
« Partie faire des courses ?
– Sans refermer la porte ?
– Si elle est sortie chercher du sel ou des allumettes chez une voisine, elle va réapparaître dans un instant. Elle nous a donné rendez-vous. On est pile à l’heure.
– Justement. Si elle a réfléchi et qu’elle n’a plus aucune envie de nous rencontrer ?
Je croisai les bras et m’appuyai contre le chambranle, entraînant l’ouverture complète et brutale de la porte. J’allais la refermer quand je vis dans le hall, éclairée par un violent rayon de soleil, une scène qui me cloua sur place.